
Une mise en regard d’anciens manuscrits, d’oeuvres artistiques du passé, et de réalisations contemporaines autour du livre biblique de l’Apocalypse.
Toutes les photos sont de l’auteur de l’article. Cliquer dessus pour un agrandissement
La France laïque et républicaine réserve parfois des surprises en matière de valorisation du religieux et plus particulièrement du religieux chrétien, fondé sur les écrits bibliques : ainsi en est-il de cette superbe exposition, intitulée Apocalypse hier et demain, proposée à la BnF François Mitterrand durant la première moitié de l’année 2025.
Évidemment, le climat anxiogène des années actuelles et des mois présents (guerres dans plusieurs endroits du monde, éco-anxiété, disparition de la biodiversité, pollution, catastrophes climatiques - ouragans, incendies, inondations, canicules - , montrée en puissance des extrêmes droites aux USA et en Europe, menaces sur les démocraties par les milliardaires libertariens, puissance militaire de régimes dictatoriaux et autoritaires, multiplication des virus...) évoquent le mot « apocalypse » qui, dans le langage courant, désigne une avalanche de catastrophes qui annoncent (peut-être) la fin du monde.
Cette dimension est bien présente dans cette exposition, mais elle n’est de loin pas la seule : d’autres sont rappelées, abondamment exposées et mises en scène : il est bien précisé que le mot "apocalypse" (du grec apocalypsis) veut dire littéralement « révélation » en non « destruction », ou « catastrophe ». Le fait, également, que ce mot renvoie à un écrit biblique, le dernier livre de la Bible, qui a son écriture et sa narration propres (il faut d’abord livre le livre, avant de pouvoir en parler et le commenter) est évidemment souligné. L’idée, très présente dans l’exposition comme dans l’écrit biblique, que ces catastrophes prendront fin, pour donner naissance à un monde nouveau, harmonieux et pacifié, est également mise en avant.
– De magnifiques Bibles enluminées. On sait que l’ Apocalypse a non seulement inspiré les tympans de nombreuses églises pré-romanes et romanes, mais (avant elles) de nombreux manuscrits enluminés ou illustrés. Un des plus anciens manuscrit exposé est une peinture sur parchemin de l’Apocalypse (Belgique ou Allemagne), datant du 1er quart du IXe siècle ; idem pour La Bible de Charles le Chauve, manuscrit du IXe siècle pour l’abbaye St-Martin de Tours. On admirera également La Bible de Roda, un manuscrit sur parchemin de la 2e moitié du XIe s., le Liber Floridius de Lambert de Saint-Omer (1061-1125) datant de 3e quart du XIIIe siècle, le Commentaire de l’Apocalypse de Bérangaud, Savoie, 3e quart du XIVe siècle. Une attention spéciale doit être accordée à trois Beatus, ce commentaire de l ’Apocalypse du VIIIe s., par le moine espagnol Beatus de Liebana, repris et illustré en style « mozarabe » par une nombreuse postérité. On reviendra sur le plus célèbre d’entre deux, le Beatus de Saint-Sever (XIe s.), réalisé pour l’abbaye St-Sever en Gascogne.
– La dimension du futur (en théologie on parlera d’eschatologie et de messianisme et en philosophie, d’utopie), est soulignée en dernière partie d’exposition ("le monde d’après"), avec des œuvres contemporaines parfois déroutantes, mais qui évoquent un monde nouveau, énigmatique et meilleur ; un monde qui n’est plus dominé par l’humain, voire un monde dans lequel l’humain a disparu (ce qui n’est pas forcément une belle utopie).
– En ce qui concerne les œuvres contemporaines montrées, les commentaires font bien la différence entre les œuvres qui s’inspirent explicitement de l’un ou l’autre détail présent dans l’ Apocalypse (les 4 cavaliers, le combat de la femme, de l’archange et du dragon, le livre mangé), et d’autres qui peuvent ou pourraient évoquer des thèmes présents dans le livre de la Révélation, sans qu’il soit certain que cette référence ait été présente ou consciente chez l’artiste ; c’est le cas, par exemple, dans les œuvres de Kiki Smith (née en 1954). Parmi des œuvres contemporaines remarquables par leur notoriété :
– Quelques peintures colorées de Wassily Kandinsky (1866-1944), qui se réfèrent explicitement à l’Apocalypse.
On sait que le créateur du Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), l’un des deux mouvements de l’expressionnisme allemand, par ailleurs initiateur de l’art abstrait, était fasciné par ce livre biblique, qui l’a aidé à s’émanciper de la figuration.
- Une sculpture de Germaine Richier (1902-1959) (la réalisatrice du fameux et contesté "Christ d’Assy"), Le cheval à 6 têtes (1964-1966). Si la référence n’est pas explicitement biblique, elle fait penser aux 4 chevaux d’ Ap 6
– On trouve aussi des œuvres tout à fait contemporaines, comme un bronze de Ali Cherri (né en 1976), Arbre de vie, qui date de 2024.
A propos de cette œuvre, le cartel propose le commentaire suivant : "Présent dans différentes cultures, l’arbre de vie véhicule une grande richesse symbolique. Dans l’Apocalypse, il est mentionné dans la lettre à l’Église d’Éphèse, puis pour décrire la Jérusalem céleste. Ali Cherri a choisi pour modèle de sa sculpture un bas-relief assyrien conservé au Louvre. Pour lui, l’arbre de vie symbolise le cycle des vivants".
– Une place importante à été faite au cinéma, avec des extraits de grands films qui s’inspirent directement de l ’Apocalypse, parmi lesquels, évidemment, Métropolis (1927) de Fritz Lang, Le 7e Sceau (1957) d’Ingmar Bergman, ou Apocalypse now (1979), de Francis Ford Coppola.
– Une présentation scénarisée et pédagogique : l’exposition est structurée sous forme de « jeu de découverte » ou de « jeu de piste », avec un parcours qui se concentre sur quelques grandes articulations ou thématiques du livre biblique ( « Qu’est-ce que l’Apocalypse ? » ; « Le temps des catastrophes » ; « La Révélation à l’épreuve de la raison » ; « Le jour d’après »).
– Des cartels synthétiques accompagnent les plus grandes œuvres ; ils ne se contentent pas de donner le titre, l’année de réalisation, le lieu de conservation, mais commentent brièvement l’œuvre (ou la série d’œuvres) exposée.
– Quelques pièces d’exposition uniques, exceptionnelles par leur ancienneté ou leur célébrité, sont données à voir. Elles traduisent la diversité des époques, mais aussi des matériaux, des techniques et des styles qui furent au service d’une interprétation visible d’un récit visuel :
– La dimension christique, l’eschatologie réalisée, qui sont les authentiques clés de lecture de l’Apocalypse sont minimisées, voire passées sous silence. Il s’agit pourtant bien d’une vision donnée à Jean "de la part de celui qui est, qui était et qui vient" (Ap 1,4), « de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le souverain des rois de la terre » (Ap 1,5). Que les visions montent « quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme" (Ap 1,13 ; 14,14), « quelqu’un qui était assis sur un trône » (Ap 4,2), « l’Agneau » triomphant (Ap 6,1 ; 7,17 ; 14,1), « le trône de Dieu » (Ap 7,15), elles ne sont à comprendre que comme une récapitulation du geste christique, un aboutissement de la dynamique biblique que l’on pourrait résumer par ces 4 phases théologiquement signifiantes : incarnation-crucifixion-résurrection-glorification.
– Les références vétéro-testamentaires ne sont pas rappelées : impossible de comprendre la symbolique du livre biblique de l’Apocalypse sans un retour à de nombreux récits de l’ Ancien Testament, lesquels sont constamment repris, réinterprétés, actualisés. Les références vétéro-testamentaires sont présentes partout, presque à chaque verset. Elles sont particulièrement appuyées ce qui concerne les images symboliques des 4 Vivants autour du trône céleste (Ap 4 qui reprend Ézéchiel 1) ou du livre mangé (Ap 10 qui reprend Ezéchiel 3), ou de la vision du Fils d’homme qui se réfère à Daniel 7. De cette intertextualité, il n’est point question, ou si peu.
– Cette dimension herméneutique du texte biblique, à laquelle font écho les images, elles aussi interprétantes et à interpréter, aurait dû être mieux mise en avant, en montrant que l’écriture biblique est non seulement à interpréter, mais qu’elle est elle-même interprétante, selon l’adage de la Réforme que l’Écriture est à elle-même sa propre lumière.
– Les travaux des exégètes et spécialistes de cet écrit biblique ainsi que de la littérature du christianisme antique sont ignorés.
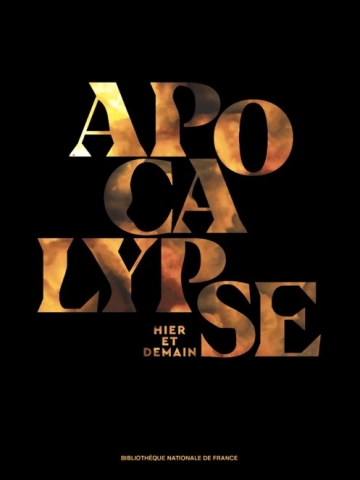
Le catalogue de l’exposition réunit 14 auteurs, essentiellement, sinon exclusivement, des philosophes, écrivains, médiévistes, historiens et conservateurs de musées et de collections. Parmi les plumes, on trouve deux érudits très médiatiques (Frédéric Boyer, Georges Didi-Huberman). Mais des biblistes ou historiens du christianisme antique, point s’en trouvent. Pourtant, il n’en manque pas sur la place de Paris (et ailleurs). De surcroît, le catalogue ne suit pas le déroulement de l’exposition (aurait-il été réalisé avant la conception de l’exposition ?). Il ajoute des œuvres qui n’y sont pas et supprime d’autres qui s’y trouvent. Certaines reproductions sont peu ou mal légendées (il manque par ex. la dimension des œuvres). Le lecteur averti est frustré, même si techniquement, l’ouvrage est bien fait, abondamment illustré, pour un prix modique.
– Du point de vue des œuvres montrées, un oubli : les illustrations de l’ Apocalypse de l’artiste expressionniste allemand Max Beckmann (Marx Beckmann, Apokalypse. Der Wiederaufgefundene handkolorierte Zylus, Wiesbaden, 2004), réalisées en pleine guerre en 1941, et qui furent exposées il y a quelques années à Metz et dans plusieurs villes allemandes (Wiesbaden, Goch, Heidelberg, Osnabrück, Francfort). Il est sans doute le seul artiste contemporain de grande notoriété à avoir inséré ses reproductions colorées à l’intérieur du texte lui-même. A défaut de pouvoir exposer cette œuvre contemporaine unique, il fallait au moins la mentionner.

– Mais il y a plus embêtant encore, selon moi : l’art d’Église, l’art liturgique a systématiquement été laissé de côté, oublié ou ignoré, je ne sais. On n’en trouve aucune trace dans l’exposition. Certes, l’art liturgique, religieux, sacral (on l’appellera comme on voudra) ne brille pas par sa créativité ; il se caractérise essentiellement par son conservatisme, sa platitude, son caractère "saint-sulpicien". Mais il y a quelques heureuses exceptions. Et elles tournent souvent autour des représentations de l’Apocalypse, puisque ce sujet, eschatologique, est souvent représenté dans le chœur des Églises. Je n’en donne qu’un exemple, et un exemple remarquable : dans le chœur de l’église N-D de Toutes-Grâces, construite par Maurice Novarina entre 1937 et 1946 sur le plateau d’Assy en Haute-Savoie, et qui contient des joyaux de l’art contemporain du XXe siècle (grâce à l’intense activité artistique du dominicain Alain-Marie Couturier), on trouve une superbe et immense tapisserie du célèbre artiste Jean Lurçat, représentant précisément le combat de la femme et du dragon d’Ap 12. On aboutit alors au surprenant paradoxe suivant : l’exposition de la BnF montre bien une tapisserie de Lurçat (dont le thème n’est pas l’Apocalypse), mais ignore celle, bien plus célèbre, du même artiste sur un texte central de notre récit biblique ; parce qu’elle se trouve dans une église ? On ne peut pas ne pas se poser la question.
Malgré ces limites, on ne peut que se réjouir du fait que ce livre fascinant de la Bible – le seul que Calvin n’ait pas commenté – soit autant mis en valeur, l’exposition bénéficiant d’une couverture médiatique exceptionnelle.
Jérôme Cottin